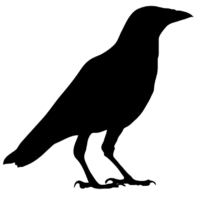ÉTUDES
La géopoétique, une présence entière au monde
Régis POULET
Il est possible de distinguer trois niveaux de réalité : le Cosmos, qui est la totalité de ce qui existe dans toutes les directions et dimensions de l’univers/plurivers ; la Terre, qui est la partie du Cosmos où vivent l’humanité et tous les êtres vivants ; un monde, qui est la représentation que des humains se font de la Terre et du Cosmos. Le changement est constant sur ces trois niveaux : de ce que nous en savons, le Cosmos a une existence d’une quinzaine de milliards d’années, mais il n’est pas exclu qu’il connaisse des cycles de création/destruction. La planète Terre, elle aussi, a une existence déjà ancienne, plus de quatre milliards d’années durant lesquelles les changements incessants à toutes les échelles spatiales et temporelles ont été et sont encore la règle. Quant aux mondes, ils se succèdent au fil de l’histoire humaine. Le monde des Néandertaliens n’était probablement pas celui des Homo sapiens et, depuis que cette dernière espèce s’est imposée, les civilisations se sont succédé jusqu’à notre époque où l’effondrement généralisé menace à cause de l’emprise technico-métaphysique sur la Nature. Le monde dans lequel nous vivons est mortifère et moribond. Il faut donc en changer, mais pour lequel ?
1 – PREMIÈRE APPROCHE
Pendant des décennies, Kenneth White a parcouru en nomade intellectuel les cultures du passé et du présent, avec l’idée que chaque culture offre un point de vue partiel et qu’en nomadisant de l’une à l’autre à la recherche du meilleur de chacune d’entre elles dans le rapport au monde naturel, on pourrait dessiner les contours d’une culture complète dans un monde ouvert. Comme il l’écrit dans Magna Carta : « Difficile est la sortie de la Modernité, sans régression vers de vieux symbolismes, sans fuite en avant ». Pour qu’il y ait une culture au sens fort du terme, il faut que les humains, à tous les niveaux de la société, partagent une référence commune forte.
Durant la préhistoire, ajoutait-il, c’était le rapport à l’animal ; durant le Moyen-Âge chrétien, la référence à la Vierge. À notre époque de globalisation des échanges, de ruine technico-capitaliste qui entraîne tout vers le néant, le seul point commun possible est le rapport à la Terre.Mettez les hommes en rapport avec la Terre, dit-il, et ils auront entre eux un lien plus fort que s’ils sont seulement mis en rapport les uns avec les autres. La suite logique du nomadisme intellectuel est la géopoétique. Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler rapidement ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas.
La géopoétique n’est pas une géographie littéraire, vaguement lyrique. Elle est un champ de convergence des arts, des sciences et de la philosophie ouvrant sur une refondation du rapport entre les humains et la Terre. Kenneth White et moi avons longuement abordé, dans des entretiens, la question des différences entre la géopoétique et les autres géo- : géopolitique, géocritique, géophilosophie, etc. dans le livre Panorama géopoétique (2014).
Je voudrais cependant insister un peu plus sur le rapport entre écologie et géopoétique, et citer pour cela Kenneth White :
« Être écologiste, c’est s’intéresser à la manière dont les êtres humains et non humains vivent dans un espace et c’est aussi respecter et vouloir préserver les espaces vivants.
La géopoétique, c’est établir le rapport à cet espace. Pas seulement le conserver, le préserver, mais établir un rapport sensible et intelligent.
Ce qui demande un changement dans la personne, un changement de l’être, ça va plus loin.
Ensuite, il faut essayer de la dire, c’est-à-dire qu’il faut changer notre langage.
Il y a deux étapes de plus. » (Le lieu et la parole)
L’écologie est une des strates de la géopoétique, indéniablement, mais la géopoétique propose et demande davantage : un changement dans la personne qui implique de se défaire des obsessions identitaires, en chemin vers le concept d’un être ouvert aux flux du monde ; un changement dans notre façon de dire notre rapport au monde, dont on sait qu’elle est enveloppée dans la grammaire. Cela commence, notamment, par une parole qui ne met en avant « ni le moi, ni le mot, mais le monde ». Autrement dit une attention à la poétique de la Terre.
2 – AUX SOURCES DE LA GÉOPOÉTIQUE
Inventée par le poète et penseur franco-écossais Kenneth White à la fin des années 1970 (mais les prémisses remontent très loin dans son expérience) lors d’un périple au Labrador (La Route bleue, 1983), la géopoétique n’est pas surgie de nulle part. Parmi les précurseurs d’une vision du monde renouvelée et plus riche mise en avant par White dans ses essais, signalons Victor Segalen, Henry Thoreau ou encore Alexander von Humboldt. Kenneth White considère que le Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent de Humboldt (30 vol., 1807-1834) constitue « une pérégrination géopoétique par excellence », de même que Cosmos. Essai d’une description physique du Monde (4 vol., 1847-1859) est une de ces synthèses magistrales comme les esprits du XIXe siècle pouvaient en produire.
Ce qui retient particulièrement l’attention chez Humboldt, ce ne sont pas seulement ses contributions tous azimuts à la science universelle. S’il fut un savant d’une grande précision et de grande envergure, il ne faut pas le voir comme un savant austère mais plutôt comme un « amoureux fervent » (Baudelaire) du monde. S’il a parcouru pendant cinq années, et souvent dans des conditions matérielles plus que difficiles, la Nouvelle Grenade et le Pérou, la Nouvelle Espagne, de Cumaná à San Carlos, de Carthagène à Quito, de Lima à Veracruz, c’est parce qu’il y était profondément heureux. Voici ce qu’il écrit à son arrivée à Cumaná : « Nous sommes ici, enfin, dans le pays le plus divin et le plus merveilleux. Des plantes extraordinaires, des anguilles électriques, des tigres, des tatous, des singes, des perroquets et de nombreux, très nombreux Indiens purs, à demi sauvages, une race d’homme très belle et très intéressante. Depuis notre arrivée, nous courons comme des fous… Je sens que je serai heureux ici. » Chez Humboldt, le savoir est lié à l’être, l’être est lié à l’environnement et, grâce à une préoccupation esthétique, on sent que l’esprit peut se projeter loin — là où une vision du monde, riche et habitable, un cosmos, s’élabore : « un ensemble de rapports, écrit-il, qu’il est plus facile de saisir, lorsqu’on est sur les lieux, que de définir avec précision ». On pourrait dire que Humboldt passe par une gaya scienza pour approcher la géopoétique.
Mais il revient à Kenneth White d’avoir fondé cette théorie-pratique.
C’est en 1994 qu’il consacre un premier essai exclusivement à la géopoétique. Le Plateau de l’Albatros – Introduction à la géopoétique, dont le nom est emprunté à ce plateau qui émerge à peine de l’eau à mille milles marins des Galapagos — « quel meilleur symbole pour une pensée (celle de la géopoétique) en émergence ? » Le Plateau de l’Albatros n’est pas un manuel de géopoétique : « L’accent, ici, n’est pas mis sur la définition, mais sur le désir, un désir de vie et de monde, et sur l’élan. » Il ne s’agit pas de fonder un mouvement littéraire, notamment parce que le ‘poétique’ est à prendre dans son sens de ‘formation et dynamique fondamentales’ susceptible de se manifester tant dans les sciences que dans les arts ou le langage — et non dans le sens ‘en rapport avec la poésie’. Il n’est pas davantage question de fonder un système, au contraire : on reste dans l’ouvert et dans le refus du dogmatisme parce que la théorie géopoétique est inséparable de sa pratique, c’est « une idée de base qui ne se laisse pas définir in abstracto mais qui se dessine in vivo, à partir de plusieurs contextes ».
Le projet géopoétique doit constituer, dans l’histoire de l’esprit, un nouvel outil ou instrument pour comprendre et exprimer notre relation au monde. Il succédera ainsi à l’Organon d’Aristote (celui de toute l’époque classique), au Novum Organum de Bacon (celui de la modernité) et sera un organum pour aujourd’hui et pour demain : Organum Geopoeticum. Dans Panorama géopoétique, White précise :
« L’espace d’Aristote était la Méditerranée. Celui de Bacon était, déjà, une mer plus mouvementée, qui s’étendait au-delà des Colonnes d’Hercule : l’Atlantique (« le site le moins clos », dit Saint-John Perse), et, au-delà, l’Océan mondial. Ouverture totale, avec beaucoup de risques, beaucoup de catastrophes à l’horizon. Comme le dit Melville, dans Moby Dick : ‘Toute pensée profonde vient de l’effort intrépide déployé par l’âme pour maintenir l’indépendance d’une mer ouverte.’ » (PG 99-100)
Travailler à la géopoétique, c’est s’ouvrir, intellectuellement et sensiblement, à la poétique à l’œuvre dans la nature, à la poétique naturelle spontanée. La méthode du nomadisme intellectuel (« nord, sud, est, ouest — monde ancien et monde moderne ») et le but de la géopoétique sont l’étude des rapports complexes entre le moi, le mot et le monde, la recherche d’une expressivité nouvelle, d’une poétique de la Terre.
Pour cela, « la démarche géopoétique explore la voie archaïque et la voix anarchique, avant de s’engager sur d’autres voies sans nom ».
3 – L’ARCHAÏQUE NOUVEAU MONDE
La pratique de la dérive, du nomadisme et de l’errance est fondatrice de la géopoétique, mais elle ne s’y réduit évidemment pas. La grande errance américaine commence bien avant les Pilgrim fathers du Mayflower. Parce que « les mondes en gestation et en développement ont tendance à se figer en empires », White suit dans l’histoire du Nouveau monde les traces des peuples errants. La question du ‘Nouveau monde’ est libérée de ses bornes vespuciennes pour être restituée à sa quête indéfinie. Et il faut bien dire que les connaissances relatives au peuplement du continent américain sont en évolution constante.
Pendant longtemps le peuplement originel des Amériques a été envisagé sous la forme d’une grande migration d’Asiatiques passés par le détroit de Béring durant le Paléolithique, grâce à un corridor libre de glace il y a 13000 ans. C’était la position inamovible des préhistoriens états-uniens. Mais des découvertes se sont accumulées depuis quelques décennies aux États-Unis, au Chili et au Brésil tendant à prouver que la présence humaine aux Amériques est non seulement beaucoup plus ancienne que la théorie du détroit de Béring, mais que le peuplement se serait effectué à plusieurs époques et selon des routes diverses. Pour en dire quelques mots, le plus ancien peuplement, selon la théorie audacieuse de la préhistorienne et anthropologue franco-brésilienne Niède Guidon, aurait eu lieu depuis l’Afrique de l’Ouest vers la côte nord-est du Brésil aux alentours de 100 000 ans BP. Des découvertes au Brésil, comme à Pedra Furada ou à Pedra Pintura (notamment étudiée par un de mes anciens professeurs en paléontologie, Claude Guérin) ont montré que le peuplement y est avéré entre 11 000 BP et 38000 BP. Des hypothèses complémentaires soutiennent avec vraisemblance une migration depuis le Nord de l’Asie le long des côtes occidentales des Amériques, théorie de la route des forêts de Kelp (des algues côtières), il y a 16 000 ans, lorsque le bouclier glaciaire empêchait encore le transit par l’Alaska et le Canada. Il existe aussi une théorie qui affirme que le peuplement de l’Amérique du Sud se serait fait depuis le Sondaland (la province des îles de la Sonde en Asie du Sud-Est) en passant par le Pacifique Sud il y a 50 000 ans. Les différents clans auraient essaimé dans tout le continent américain.
Pourquoi tant valoriser ces dérives ? Parce que « voyage et vision vont ensemble, l’un n’est pas possible sans l’autre ». Autant les fondateurs de cités, d’états et d’empires, en devenant sédentaires, sont capables d’imposer leur vision humaine de l’existence à des humains, autant les nomades en désir-de-monde ont conscience de l’illusion de la plupart des buts humains. Ils restent en contact avec le monde et ne fondent pas leur culture, comme le firent les Grecs à partir de leurs cités, sur une démesure qui n’est qu’un trou noir. Passons de ces considérations anthropologiques et archaïques à des considérations contemporaines et individuelles — c’est ce que permet de faire le nomadisme intellectuel.
4 – DES CARTES ET DES CHARTES
En 2020, Kenneth et moi avions caressé l’idée de nous rendre ensemble en Amérique du Sud, au Brésil et au Chili notamment, où la géopoétique suscite un intérêt marqué. Cela n’a pas pu se faire. Kenneth a beaucoup visité l’arc caraïbe et j’ai, pour ma part, visité un pays voisin du Brésil : le Venezuela. De mes voyages de part et d’autre de l’Atlantique j’ai tiré un très long poème (de plus de 100 pages) intitulé Gondawana. Bien que Kenneth n’ait pas foulé le sol sud-américain, il avait lu beaucoup de récits d’explorateurs (Humboldt cité tout à l’heure, Jean de Léry, Claude D’Abbeville notamment) et fréquenté d’anciennes cartes. Il en a tiré le livre Magna Carta, illustré par Dominique Rousseau.
Bien que je ne place pas ces deux livres sur le même plan, permettez-moi de parler rapidement du mien dont Kenneth a dit qu’il était « en plein dans la géopoétique », considérant que c’était « énorme ». Voici comment est présenté le poème :
« À l’heure où le destin collectif des êtres vivants est menacé, ce long poème évoque l’épopée de l’espèce humaine depuis ses origines jusqu’à nos jours dans son rapport toujours étroit aux lieux marins et terrestres, aux êtres vivants qui les ont peuplés et les peuplent encore.
L’exploration physique et mentale contemporaine de plusieurs régions de l’ancienne province géologique du Gondwana — avec ce -a de l’origine et des nouveaux commencements qui apparaît au cœur de Gondawana — donne à ces vers la force d’une expérience intensément vécue au contact des éléments, du monde naturel et des peuples, à la recherche de l’ordre anarcho-archaïque le plus riche pour ouvrir et fonder un monde. » (Gondawana)
L’écriture y suit la double voie du nomadisme intellectuel et de la géopoétique. À savoir qu’elle repose sur l’intégration (la plus efficace et discrète possible) d’éléments de savoirs naturalistes (géologie, paléogéographie, botanique, zoologie, astronomie) et humains (ethnographie, histoire, philosophie, linguistique) qu’il s’agit de faire entrer en résonance pour en tirer une parole pleine sur les lieux.
Le cas de Magna Carta est assez différent mais illustre la double exploration à l’œuvre dans le binôme ‘nomadisme intellectuel-géopoétique’. Contrairement à Gondawana, l’exploration sensorielle-physique et l’exploration mentale-abstraite ne sont pas accomplies par la même personne mais par deux : Kenneth White pour le texte géopoétique et Dominique Rousseau pour la matière visuelle géopoétique, l’ensemble étant organisé par le poète. Ainsi les longs séjours de Dominique Rousseau au Brésil lui ont-ils permis d’endosser le rôle de collecteur de lignes du monde, ses discussions avec Kenneth White et les papiers qu’il a créés pour lui permettant à ce dernier d’entrer dans un dialogue esthétique avec les terres du Brésil. White précise ainsi dans Magna Carta la différence entre perception et sensation : la première saisissant les formes de la matière-monde, la seconde, ses forces, les deux conjuguées visant à créer une version du monde qui constitue en soi un monde.
Avec ce livre écrit sur le Brésil pour le Brésil avec une répartition inédite des rôles, Kenneth White montre de façon originale de quelle façon la question du lieu peut être envisagée dans la géopoétique.
5 – LA COMPLEXITÉ DU LIEU
Dans son traité intitulé La Physique, Aristote signalait déjà que le lieu est quelque chose de complexe, qu’il y a un lieu du lieu et que le lieu a une puissance. Pour nous en tenir aux fondamentaux de la géopoétique, disons tout d’abord qu’aucun lieu n’est isolé. Avec quelques connaissances en géologie, il est possible de relier le présent au passé le plus lointain et ici à là-bas, une lecture du paysage permettant de comprendre les forces qui l’ont façonné. De même, avec des connaissances sur les animaux, on peut suivre les migrations des oiseaux et des insectes qui nous introduisent aux flux et aux équilibres du vivant. Enfin, si l’on peut dire, l’observation des pluies et des cours d’eau, des brumes et des courants marins, ou l’attention aux vents, rendent non seulement intelligibles mais sensibles les rapports dans le temps et dans l’espace entre les éléments, le minéral, le végétal et l’animal dont les frontières sont parfois si floues.
Le problème que nous, humains, rencontrons dans notre lecture du réel, c’est que « nos représentations ne correspondent pas à la totalité complexe du réel, que nos structures mentales (érigées en religions, idéologies, philosophies) bloquent une présence entière au monde » (Magna Carta). Ainsi un lieu est-il bien plus qu’un ensemble de coordonnées physiques, historiques, climatiques. Un lieu est non seulement cela mais aussi le jeu que les forces et les formes qui le parcourent sans cesse lui font prendre, même brièvement, même à toute petite échelle. Le lieu est constitué d’un ensemble de ce qu’on pourrait appeler des ‘dimensions de l’existence’ ouvertes les unes sur les autres. Pour re-connaître ces multiples dimensions de l’existence, il faut d’abord les connaître, c’est-à-dire sentir leur réalité dans un corps et dans un esprit.
J’aimerais finir, sans conclure, en citant ces vers du dernier recueil de Kenneth White, Mémorial de la terre océane, qui disent en toute simplicité à quoi ouvre la géopoétique :
« Arriver dans un lieu
où il n’y a
ni complications
ni explications
on avance pas à pas
s’en tenant entièrement à
ce qui est là. »
Ce texte a fait l’objet d’une première présentation lors du Premier Symposium de Rencontres transatlantiques de Labgéopoétiques, le 18 juillet 2024 à Bahia, Brésil.