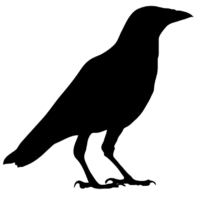ŒUVRES
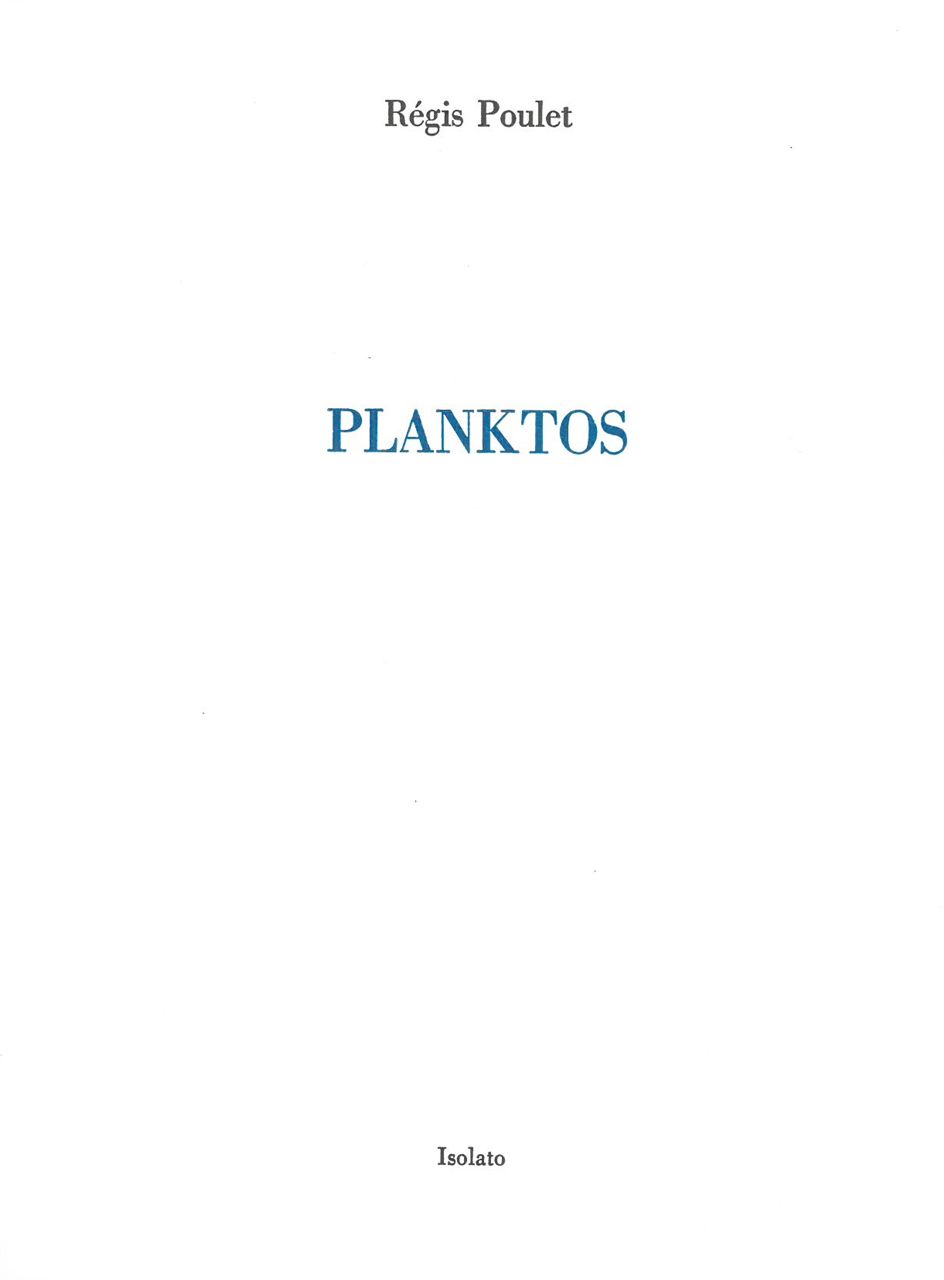
Planktos
Poème
Le Livre
2018
21,5 x 16 cm
96 pages
Livre broché
ISBN 9782354480455
Isolato Éditeur, Nancy.
Extrait
Postface de Kenneth White
Si la théorie-pratique de la géopoétique se situe dans un champ plus vaste (une totalité ouverte, un monde en mouvement) que celui de la poésie telle qu’elle est communément comprise, elle s’applique aussi à ce domaine. Il y a une poétique géopoétique.
Celle-ci n’est pas, par exemple, un exercice de beau langage tournant autour de lieux communs, pas l’expression d’une subjectivité, pas un fouillis de métaphores, pas un lyrisme vaguement géographique. Située en dehors de tout ce qui est encore mythologique, religieux et métaphysique dans la pensée et dans la culture, elle est en rapport avec la poéticité inhérente à la nature même des choses.
Régis Poulet, dont je connais les qualités intellectuelles depuis longtemps, est parmi les meilleurs connaisseurs de toute cette démarche. Quand il m’a dit qu’il était en train de composer un long poème, Planktos, je m’en suis réjoui d’avance.
Certains lecteurs se souviendront peut-être d’un des chapitres de mon livre La Maison des marées, qui s’intitule « De Platon au plancton ». J’y raconte la visite que j’ai faite à la station de biologie marine de Roscoff, dans le Finistère. J’ai pu y admirer sous le microscope une série de diatomées, ces petites structures marines ultrafines, avant de me plonger dans l’énorme Atlas der Diatomaceen-kunde d’Adolf Schmidt. Depuis des années, les chercheurs découvrent de nouvelles structures auxquelles ils donnent, à chaque fois, un nom. Ce qui fait beaucoup de diatomées, mais toutes font partie du plancton. Ce mot de plancton fut introduit dans la science océano-biologique par Victor Hensen, professeur de physiologie à l’université de Kiel, pour indiquer tout ce qui flotte dans la mer, et qui prend sa place à côté du necton, tout ce qui nage, et du benthos, les créatures des grands fonds. En disant « De Platon au plancton », j’entendais un mouvement de l’un au multiple, d’un idéalisme à un réalisme, d’un essentialisme au flux de la matière-énergie, qui véhicule forces et formes. C’est la logique sous-jacente à la géopoétique, sa géo-logie, si je puis dire.
Or, Régis Poulet est géologue de formation. C’est dire qu’il connaît les structures et les cataclysmes de notre planète. Il est aussi ornithologue, c’est dire qu’il n’ignore pas les coups d’ailes, les envols, les grandes migrations. Tout cela constitue un arrière-fond, un terrain.
Pour présenter les principes et les perspectives de la poétique géopoétique, j’ai proposé trois formules : eros, logos, cosmos ; landscape, mindscape, wordscape ; information, enformation, exformation.
C’est peut-être la troisième – information, enformation, exformation – qui s’applique plus particulièrement ici.
Par le premier terme, il faut entendre la collecte d’éléments du savoir. De nos jours, ils sont plus nombreux que jamais. On parle même de notre époque comme du « siècle de l’information ». Tant que cette information reste de l’ordre de bits statiques accumulés, on peut parler d’un excès d’information et même, à cause de cet excès, par la répétition monotone, d’une stérilisation de l’intelligence. Pour que l’intelligence fonctionne avec sa pleine capacité et sa pleine efficacité, il faut traduire le statique en termes dynamiques, il faut sélectionner, ordonner, composer. C’est ici qu’intervient le deuxième terme de la formule : enformation. Comme l’indique le préfixe « en », il s’agit d’une « intériorisation », mais d’une intériorisation sans subjectivisme, à savoir émotivité, états-d’âme, moralisme. Et l’on arrive ainsi au troisième terme : exformation. Celui-ci indique un terrain des limites, des lisières, des confins, des marges. Étant donné que toute information, même enformée, est partielle, l’exformation consiste à ouvrir le texte, violemment ou discrètement selon les occasions, au chaos et au vide.
Ici, les éléments d’information sont non seulement multiples, mais de divers ordres, notamment géologique, biologique, ornithologique, linguistique.
Le lieu d’exploration privilégié dans Planktos est la zone subarctique, qui fut, généalogiquement, le territoire de base de l’expérience géopoétique : Écosse, Islande, Atlantique Nord. L’Écosse : une symétrie brisée. Particulièrement évidente sur la côte ouest, dans la région des Hébrides, les Innse Gall du poème, sur des îles telles que Skye, Mull, Arran, où James Hutton, un des pionniers de la géologie, auteur d’une Théorie de la Terre (Édimbourg, 1795), a découvert et analysé le phénomène de la non-conformité. Territoires d’une complexité sans pareille, due à une activité ignée intense et prolongée à l’époque tertiaire. Laves basaltiques, roches plutoniques, granit, gneiss lewisien. Intrusions, dislocations. À l’origine, des plateaux volcaniques faisant partie intégrante d’un continent graduellement dénudé, érodé. C’est à ce continent qu’appartenait aussi l’Islande, avec cette différence, que l’activité volcanique y est encore vive, comme le manifeste le deuxième volet de ce triptyque, Vatnajökull (« mille mètres de glace étendus sur dix volcans »). Après les rives de l’Écosse et de l’Islande, le poème suit la pérégrination panocéanique du plancton. C’est là que l’on passe du géologique et du thermodynamique au biologique.
L’auteur ne fait pas de paysagisme descriptif, il suit, re-présente tout ce mouvement convulsif et abrupt. En se concentrant ici et là sur tel ou tel phénomène. Par exemple, celui du granit, cette roche émergée, par refroidissement, d’un magma fait d’une multiplicité de matières, avec divers seuils de cristallisation donnant lieu à des cristaux hétérogènes, formant ainsi un agrégat fort.
Tout au long du poème, l’auteur se pose des questions à propos de l’expression, de l’articulation, de la poétique. Dans Na h-Innse Gall, ceci : « Quelle parole à venir ? » Dans Vatnajökull : « Donner voix/aux saisissements/quand rien/n’est autrement visible/que par diagrammes. » Dans Planktos : « Il nous faut un langage/pour trouver notre sol/et formuler la vie », et « poétique à élucider ». Or, ces questions sont posées surtout à l’intention du lecteur qui ne sait peut-être encore rien, ou pas grand-chose, du questionnement et de l’enjeu de la géopoétique. L’investigateur-compositeur, lui, Régis Poulet en l’occurrence, est déjà très au courant à la fois de la logique, du lexique, du langage de la géopoétique, des expériences et des élucidations de cette théorie-pratique, comme cela est évident partout dans le texte.
Je salue en Planktos un remarquable exemple de géopoétique fondamentale.
Kenneth WHITE
Mars 2018
Deux recensions du livre
Michèle DUCLOS : « Avant même d’aborder le contenu et la teneur du volume, deux caractéristiques de ce texte en vers libres très courts sautent aux yeux du lecteur : la première l’apparente à une longue tradition musicale, à savoir une exubérance d’allitérations et d’assonances à la rime ou à l’intérieur du vers, sans effet d’artificialité, d’une grande beauté, jointe à un rythme très net d’alternance entre syllabes courtes et longues sans non plus d’artificialité. Comme si l’ouïe venait renforcer la volonté de rendre plus concrets les traits de paysages précis, nommés mais échappant à une représentation visuelle directe : « aujourd’hui les Red Hills / sont léchées par la brume / le long du loch Slapin / » (on notera aussi ici comme ailleurs l’emprunt au vocabulaire animé pour dire la non séparation d’avec le minéral). La deuxième caractéristique verbale est une grande diversité lexicale où se mêlent termes rares voire techniques, souvent d’origine scientifique liés aux paysages terrestres, marins et aériens qui sont le cadre et le sujet des trois parties du volume, à savoir l’aire d’une mer multiplement poissonneuse avec ses vagues et ses roches que survolent les multiples oiseaux qui complètent un cosmos dynamique. » (LIRE LA SUITE)
Danièle LAUDRIN-CHASTAING : « Dès le début de la lecture, en « embarquant » avec l’auteur sur des chemins à découvrir, ce qui me frappe est l’ouverture vers le long temps associée à la présence du furtif dans l’ici et maintenant [1]. Les éléments du dehors — roches, eau, brume, étourneaux ébouriffés, etc., sont omniprésents. Le regard du poète sur le lieu est celui du géologue, de l’ornithologue, ce qui n’étonnera personne puisque c’est sa formation et sa pratique. Il peut aussi rappeler celui d’un peintre, et par la suggestion de la lumière et les notations de couleurs [2], et par la composition, avec par exemple à l’arrière-plan la montagne et au premier plan les étourneaux ou un « petit cul de bergeronnette » : un point jaune.A vrai dire pourtant, plus que du regard de peintre je devrais parler d’un regard de vidéaste car ce point jaune s’agite, et le paysage donné à voir dans ces longs poèmes est souvent dynamique, changeant : attention fine portée aux mouvements fugaces de la brume, de l’eau, des reflets « éparpillés ». Attention portée aux passants parmi les roches et leur apparente immobilité : quelques fous de Bassan, trois cormorans, un goéland. » (LIRE LA SUITE)